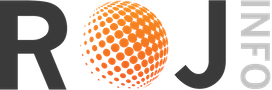Si l’histoire est fictive, les faits qui y sont racontés sont eux bien réels. Elle est le sombre quotidien vécu par des millions de Turques et de Turcs à travers le pays.
Cela fait bien longtemps que je ne mets plus de réveil. Ce matin et comme chaque lundi, c’est l’hymne turc qui me tire de mon sommeil. Je vous le concède, j’ai connu plus agréable pour m’éveiller. Derrière la fenêtre de mon appartement dont je peine à payer le loyer, j’observe les dizaines d’élèves de l’école voisine chanter İstiklâl Marşı (« La marche de l’Indépendance ») comme il est de coutume en début de semaine dans les établissements scolaires turcs. Aligné.es et droit.es dans la cour, ils reprennent en chœur les paroles sous le regard sévère d’Atatürk. Son portrait domine une aire qui, je crois, devrait être réservée au jeu et à l’insouciance de ces enfants. Ils regardent le drapeau frappé du croissant et de l’étoile s’élever dans les airs, hissé par un de leur camarade. Il n’est jamais trop tôt pour être un bon patriote. Sept heures du matin et les relents de cette mise en scène nationaliste rendent mon thé à chaque fois plus amer que d’habitude. Je n’ai jamais aimé les symphonies martiales, surtout quand on ne laisse pas le choix à leurs auditeurs.
Je descends les marches de mon immeuble sans convictions. Aujourd’hui encore je n’ai rien de prévu, rien qui n’ait de caractère obligatoire en tout cas. Au coin de la rue, le vendeur de journaux m’informe que l’un des derniers quotidiens libres, Özgürlükçü Demokrasi (« Démocratie libertaire »), a été fermé la veille. Journal en langue turque où travaillait de nombreux Kurdes, il n’hésitait pas à avoir une lecture critique de la politique du gouvernement d’Ankara en Syrie et dans les zones à majorité kurde en Turquie. L’État ne pouvait plus tolérer ce média qui échappait à son contrôle absolutiste. En le contraignant à la fermeture, il a encore rongé sur le peu de liberté qui subsiste ici. Pour s’informer il faudra repasser, je ne vais quand même pas poser les yeux sur l’un de ces innombrables torchons, Sabah en tête, qui se font l’écho du bien-fondé d’un pouvoir autoritaire. Je ne m’en servirais même pas pour la litière de mon chat : mon ami félin mérite mieux que ça.
J’avance à travers les rues d’une ville que je connais parfaitement et qui me semble pourtant chaque jour un peu plus étrange. Je ne remarque presque plus la silhouette menaçante des véhicules blindés que je croise sur mon chemin. Les mitrailleuses sur leurs toits balaient les trottoirs et ceux qui y marchent de leurs canons éclatants au soleil… Le long des lampadaires, le portrait d’Erdogan couplé au drapeau turc se répète à l’infini dans une sorte de mise en abyme angoissante. Celui qui se rêve en nouveau sultan ottoman y paraît plus jeune que lors de ces innombrables apparitions à la télé, son un outil de propagande favori. Même lui à l’air fatigué à force de trop parler et nous, il nous fatigue toujours autant, sans que l’on ne puisse rien dire. Parfois on n’hésite même à réfléchir, que ce soit par paresse intellectuelle ou par lassitude, mais surtout par peur de s’attirer des problèmes. La peur est devenue cette amie encombrante dont on ne se débarrasse jamais vraiment. Elle nous suit du matin au soir et nous accompagne jusque dans nos rêves que l’on a perdus.
Je retrouve dans un salon de thé des ami.es qui comme moi, ont perdu leur travail à la suite du pseudo coup d’État de juillet 2016. En fait non, nous n’avons pas perdu notre travail, on nous l’a volé, le gouvernement nous l’a volé. Les raisons invoquées sont diverses et variées, le seul dénominateur commun est une opposition réelle ou supposée au pouvoir nationaliste d’Ankara et à son chef. Exprimer son avis est devenu une faute grave. Ici, être viré.e de son travail équivaut à une mise à l’écart de la société. Impossibilité de retrouver un autre boulot, ressources financières en chute libre, fin de la sécurité sociale, liberté de circuler abolie, les « ami.es » d’hier qui ne veulent plus vous parlez… Heureusement, qu’il reste le soutien moral et parfois économique des proches, famille ou camarades.
Nous discutons, désoeuvré.es, de l’abysse sans fin dans lequel s’enfonce la Turquie depuis plusieurs années. Cela fera bientôt deux ans que nous vivons sous état d’urgence, que les décrets-lois ont remplacé la loi, la vraie. Cette nuit du 15 au 16 juillet 2016 a été une aubaine pour Erdoğan. Elle lui a permis de légitimer son emprise sur la Turquie en convaincant une partie du pays de la nécessité d’un pouvoir fort. Cette « tentative » de putsch a déjà été intégrée par les autorités au grand récit national turc : les parcs portant le nom du « 15-juillet » fleurissent dans les villes, les fresques faisant état de l’héroique résistance populaire face aux militaires insurgés colorent les rues et ces quelques heures de notre histoire récente ont déjà trouvé leur place dans les manuels scolaires. Jusque dans mes poches, je trouve des pièces d’une livre célébrant cet évènement tragique pour la liberté en Turquie.
Malgré mon passeport confisqué, nous dissertons sur le meilleur moyen de fuir cette prison à ciel ouvert qu’est devenue la Turquie d’Erdoğan. Dans notre quête de justice et de liberté, nous nous sentons abandonné.es, sans aucun soutien extérieur. Notre sort n’intéresse que peu de monde à l’étranger et nous savons qu’il faudra nous débrouiller seul.es pour sortir de l’obscurité. Le silence intéressé de l’Europe face aux causes notre désarroi fait qu’elle ne nous a jamais semblé aussi éloignée. Son attitude conciliante vis-à-vis d’Erdoğan ne nous inspire plus seulement de la déception mais une colère profonde. Sait-elle ce que vivent chaque jour des millions de citoyen.nes ordinaires en Turquie ? A la télé des images de guerre succèdent à un énième speech d’Erdoğan. Avec le sport, ces deux sujets occupent une place écrasante de l’espace médiatique audiovisuel turc. Endoctrinement et divertissement, j’avale rapidement un dernier thé et sort dans la rue, lieu public qui n’a plus rien de civique.
Ma sœur habite dans un village à une heure de route en mini-bus de chez moi. Je décide d’aller lui rendre visite, comme je le fais une ou deux fois par semaine. Elle n’a pas été licenciée mais comme des millions de citoyen.nes ici, elle est au chômage, victime de la crise économique qui sévit en Turquie et que ne parvient pas à enrayer le gouvernement. Son mari est ouvrier agricole saisonnier et pour gagner un peu d’argent, se trouve en ce moment à des centaines de kilomètres de chez eux. En attendant le dolmuş, je pense aux derniers mois vécus, aux espoirs déchus d’une paix durable en Turquie, à portée de main début 2015. Les calculs politiques de l’AKP d’Erdoğan ; parti qui se nourrit de la guerre et des oppositions des uns aux autres, ont eu le dernier mot. Retour du conflit armé dans les campagnes kurdes, écrasement de l’insurrection urbaine dans une dizaine de villes kurdes, assassinats et destructions massives, destitutions des co-maires DBP élu.es dans une centaine de municipalités, nominations à leurs places d’administrateurs AKP, coup d’État avorté et contre coup d’ État d’Erdoğan…
Je ne vois pas de porte de sortie à cette mélancolie qui m’anime et ma volonté de résister au moins mentalement à l’oppression étatique est prise en étau par son impitoyable machine. Il y a tellement de choses que l’on ne pouvait imaginer accepter et pourtant aujourd’hui, on vit avec. On pousse chaque jour le concept de résilience à outrance, on plie mais ne rompt pas. Je cherche un peu de réconfort dans le regard des gens autour de moi, une paire d’yeux amicale et rassurante où brillerait encore l’espérance que les choses changent, que rien n’est inéluctable et que même ici, tout est encore possible… Mais je ne croise que des visages fermés, fatigués presque sévères. L’autoritarisme d’Erdoğan a divisé comme jamais la société et ses appels répétés à dénoncer tout individu qui ne marcherait pas dans son ombre crée un climat de défiance et de suspicion, renforcé par une intimidante présence policière dans les villes.
Le dolmuş fini par arriver et quitte rapidement la ville pour s’enfoncer dans la campagne. Derrière les vitres fumées du véhicule, la quinzaine de passagers aperçoit à quelques centaines de mètres un imposant monastère syriaque, planté au milieu des colline et des oliviers. Comme pour l’ensemble des édifices chrétiens, sa gestion a été reprise par le gouvernement turc l’an dernier. L’État est partout, rien ne doit lui échapper. Il se manifeste encore un peu plus loin et prend cette fois-ci la forme d’un check-point routier de l’armée. A sa vue, le chauffeur coupe instinctivement la musique kurde qui me berçait jusqu’alors. Un soldat monte dans le mini-bus pour collecter les cartes d’identité, arme automatique sur la poitrine. Il en descend rapidement et tend à un autre militaire la petite pile de documents réunis. A l’aide d’une tablette tactile, il les vérifie et s’il ne trouve rien à dire ou à reprocher aux occupants du dolmuş, celui-ci peut reprendre sa route. Nous arrivons à proximité du village où vit ma sœur et sa famille. Dans les zones rurales, il est courant de voir la question sécuritaire sous-traitée par les forces de l’ordre traditionnelles (police, gendarmerie ou armée) à des citoyens choisis par leurs soins, les gardiens de village ou köy korucusu. Issus de la population locale, ces supplétifs paramilitaires de l’État turc sont là pour préserver les intérêts de leur employeur qui s’assure leur soutien en les rémunérant confortablement. Ils ont très mauvaise réputation et n’inspirent pas confiance avec leurs uniformes dépareillés. Ils incarnent la politique de la Turquie depuis 30 ans dans les régions kurdes du pays, où elle cherche à dresser les habitants les uns contre les autres. Nous connaissons tous la célèbre phrase, diviser pour mieux régner… Et ça marche.
Je frappe à la porte et c’est mon neveu qui vient m’ouvrir. Agé d’une vingtaine d’année, il est lui aussi sans-emploi et vit de petits boulots. Il a pourtant étudié la médecine à Istanbul et a même été diplômé docteur à la fin de son cursus universitaire, avec de très bonnes notes. Il n’est pas politisé mais pour avoir participé aux manifestations du parc Gezi en 2013, il ne lui est pas permis d’intégrer le monde professionnel. L’État bloque toute nomination le concernant, peu importe que le système de santé turc manque cruellement de personnel qualifié pour fonctionner correctement. Lui aussi réfléchit à s’exiler, en France, en Allemagne ou jusqu’en Australie peu lui importe, tant qu’il peut vivre sa passion de soigner autrui. Nous allons chercher sa sœur à l’école et il me dit en chemin qu’au fond, il ne peut pas partir. Il doit rester là pour aider sa famille et subvenir à ses besoins, accepter la situation telle qu’elle est et remettre ses envies personnelles à un futur incertain.
Ma nièce à 9 ans et aime beaucoup aller à l’école. Pour les jeux bien sûr mais surtout pour apprendre. Il y a quelques mois, elle a voulu porter le voile pour faire comme ses camarades mais l’idée n’est pas allée plus loin que ça. Bien qu’il y ait une sorte de mode dans les écoles autour du voile, elle trouve que ce n’est pas très pratique pour faire du sport et courir à la récréation. Dans la cours elle joue aussi bien avec des filles qu’avec des garçons, mais pour combien de temps ? Les écoles religieuses et la non-mixité des classes qui va avec poussent comme des champignons en Turquie, ce qui n’est pas sans influence sur les établissements publics. En arrivant à la maison, ma nièce me confie qu’elle n’aime pas trop apprendre les principes du djihad à la turque, soit l’amour de la patrie et de la communauté musulmane sunnite. Elle préfère la littérature classique, lire et écrire. Si je suis heureux de partager cette passion avec elle, je ne peux m’empêcher de penser que ce goût pour les lettres pourrait lui poser quelques problèmes à l’avenir.
Entre deux pâtisseries, elle me demande si toutes les langues parlées dans le monde proviennent du turc. Je n’arrive pas à cacher ma surprise, moi qui croyais cette théorie de la langue-soleil turque enterrée parmi les innombrables inepties historiques et culturelles produites par l’enseignement national. Je lui réponds que non, bien sûr que non. Sa maîtresse le leur a dit alors ma nièce doute de ma parole, il va falloir appuyer mon propos. Je trace un trait sur une feuille blanche, marque le début de l’Empire ottoman, il y a plus ou moins 800 ans. Les Grecs et les Romains, pour ne citer qu’eux, étaient présents sur le sol de l’actuelle Turquie (et ailleurs) bien avant l’arrivée des Turcomans venus des steppes d’Asie centrales. Et forcément, pour communiquer entre eux, ils devaient bien utiliser leur propre langue, comme les autres peuples dans le monde. Au fond du canapé, la fille de ma sœur fait la moue. Elle n’a pas l’air convaincu par mes explications et me répond que les Grecs et les Romains ont très bien pu créer leur langue à partir du turc parlé dans les steppes, rencontré et adopté au cours d’un de leur voyage.
A côté de moi ma sœur soupire. Elle me dit à voix basse que cela fait bien longtemps que l’on ne fait plus réfléchir les enfants à l’école, que de toute façon, la raison a quitté la Turquie. Nous prenons le dîner tous les quatre et je reste dormir chez eux le soir. Une fois ma nièce couchée, nous parlons de tout et de rien avec son frère et sa mère. Surtout du quotidien, très peu de politique. À ce sujet, tout ou presque a déjà été dit et l’on n’a plus envie de se faire mal inutilement. Je fuis la chaleur de la maison et m’allonge sur le toit de la maison, sous les étoiles. Je m’égare parmi elle comme je suis perdu en Turquie. Je ne sais plus quoi faire, où aller, je sais à peine ce que je ressens. J’ai la rage silencieuse de millions de citoyen.nes et peut-être qu’un jour, tous ensemble, on la laissera éclater. Mais je ne crois pas que cela soit pour demain.
Je suis Turc, je suis Kurde, je suis un.e enfant, je suis un.e adolescent.e, je suis une femme et je suis un homme, je suis pour la paix, je suis militant.e, je suis syndiqué.e, je suis professeur.e, je suis universitaire, je suis journaliste, je suis de gauche, je suis un esprit libre, je suis toi, je suis moi. Et malgré tout, je ne serai jamais comme ils veulent que je sois.