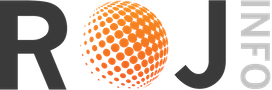La tempête soudaine qui a enveloppé les montagnes aux alentours de Van d’une couche de neige fraîche a laissé la place à un soleil brillant. La route qui grimpe les sommets jusqu’à Doğubayazit est recouverte d’une épaisse couche de glace sur laquelle circulent malgré tout voitures et autobus, tandis que les camions qui se rendent en Iran, immobilisés, attendent que la voie se dégage. A plus de 1600m d’altitude, la ville se situe sur un plateau, entourée par de hautes montagnes aux pentes escarpées et enneigées. Au nord-Est, culmine la plus haute, l’Ararat, dont le sommet à plus de 5000m d’altitude est masqué par de lourds nuages gris et blancs. Le ciel est bas et les cheminées des poêles fument, répandant à travers les rues une odeur de bois et de charbon brûlé. La ville est au cœur de la région kurde du Serhat, à la croisée des frontières turques, arméniennes, azéries, iraniennes. Un territoire dont l’occupation remonte au moins au règne d’Urartu, 600 ans avant Jésus Christ, avant d’être un royaume arménien. Le territoire, zone de contact entre empires, est marqué par de nombreuses guerres territoriales, notamment ottomano-persanes puis turco-russes. Sur le versant d’une montagne au sud, se trouve la tombe d’Ehmedê Xanî, philosophe, astronome et écrivain kurde auteur de l’épopée de Mêm û Zîn, considérée comme l’œuvre fondatrice de la littérature kurde. Important foyer de population arménienne jusqu’au génocide de 1915, Doğubayazit, comptant plus de 110 000 habitant.es, dont un tiers vit dans des villages proches, est aujourd’hui très majoritairement kurde.
Élue sur une liste du HDP, le Parti Démocratique des Peuples, principale coalition de partis d’opposition progressistes en Turquie, la maire actuelle, Yildiz Acar, s’est faite exclure du parti suite à des plaintes de ses administré.es et à une gestion opaque. Une exclusion qui lui a sans doute permis de ne pas être limogée et remplacée par un kayyum, un administrateur nommé par l’État, comme dans la plupart des autres municipalités remportées par le HDP lors des dernières élections. Un grand panneau aux couleurs délavées sur la façade vitrée d’un immeuble du centre annonce la présence des bureaux de l’organisation politique. La porte d’entrée, défoncée de multiples fois par la police, est grande ouverte. Une volée de marches mène à une grande salle où quelques hommes désœuvrés, la plupart âgés, sirotent leur thé en discutant, un œil sur l’animation de la rue principale en contrebas. Exceptionnellement aujourd’hui, aucune voiture de police ne s’est garée devant l’entrée du local pour dissuader les habitant.es de s’y rendre.

M. Abdullah Ekelik et Mme Gönül Öztürk sont les co-président.es locaux du HDP. Militant.es chevronné.es, l’une et l’autre ne comptent plus les aller-retours en garde à vue ni les séjours en prison, qui ne les empêchent toutefois pas de reprendre leurs activités politiques à peine leur liberté retrouvée. Pour Mme Öztürk, la dernière arrestation remonte à quelques jours à peine. Alors qu’en compagnie d’une autre responsable du parti, Mme Turan, elle sortait des locaux du HDP de la ville de Ağri, préfecture régionale, elle a été arrêtée par les forces de sécurité et questionnée de longues heures sur ses activités et sa présence. Si elle ne se laisse pas intimider, cette pression a toutefois un effet délétère sur les sympathisant.es du parti qui n’osent plus s’approcher du local ni être vus en compagnie de militant.es notoires, de peur de subir eux aussi la répression, où de perdre leur emploi pour les fonctionnaires. Quant aux activités politiques, « elles sont systématiquement interdites par les autorités » explique Mme Turan, également présente ce jour-là. Ancienne porte-parole du conseil municipal, elle a été démise de ses fonctions mi-décembre 2020 par un décret du ministère de l’Intérieur. Dans ces conditions, difficile pour le parti de mobiliser une base pourtant solide, mais que la chape de plomb de la répression enferme dans la peur. Les menaces de dissolution du HDP brandies par Erdoğan et concrétisées par un procureur à sa solde le 18 mars 2021, n’effraient toutefois pas M. Ekelik. Pour lui, cette agitation est une manœuvre politique en vue d’un changement de constitution qui permettrait au président d’asseoir sa main mise sur le parlement en éliminant l’opposition la plus déterminée, tout en donnant des gages de bonne foi à ses alliés ultra-nationalistes du MHP, qui demandent depuis longtemps l’interdiction du HDP. L’opération désastreuse de l’armée turque contre le PKK dans les montagnes de Garê, au nord de l’Irak, quelques semaines plus tôt a servi de prétexte au régime pour lancer une nouvelle vague de répression contre les militant.es du parti progressiste. Des centaines d’arrestations ont eu lieu à travers tout le pays. « Même si ils nous ferment, nous sommes habitué.es », explique en souriant M. Ekelik. « Nous avons déjà eu 7 partis interdits par l’État, à chaque fois, nous en avons lancé un autre. Si ils décident d’interdire le HDP, nous aurons toujours le DBP (ndlr : Parti Démocratique des Régions, parti pro-kurde composante du HDP). Les locaux sont juste au-dessus, il suffit juste d’un peu de nettoyage et nous sommes prêts ». Cette fois pourtant, ce n’est pas seulement la dissolution qui est demandée, mais aussi la saisie de tous les biens du parti, dont ses locaux, et la poursuite de ses militant.es. A mi-voix, certain.es critiquent le manque de combativité des partis de gauche à l’ouest du pays, là où il n’y a pas de checkpoints avec des militaires armés sur les routes, et ne seraient pas forcément mécontent.es de revenir à une activité politique davantage axée sur la lutte des Kurdes. Comme le montre toutefois la levée le 17 mars de l’immunité parlementaire du député turc du HDP Ömer Gergerlioglu, fervent défenseur des libertés, qui lance en kurde dans l’Assemblée le slogan « Berxwedan jiyan e » à l’annonce de la sanction, signe fort d’union des peuples, l’opposition turque de gauche effraie encore le régime par l’exemple qu’elle donne dans une Turquie qui s’enfonce dans une crise économique toujours plus dure avec un coût de la vie qui explose et alimente les mécontentements – raison de plus pour le pouvoir de chercher à détourner l’attention du peuple.
À l’instar du reste du pays, la crise touche durement Doğubayazit, comme l’explique M. Ekelik. Nombre d’habitant.es de la ville et de ses environs tirent leurs maigres revenus des exploitations rurales et de l’élevage. « Mais l’État n’encourage pas l’agriculture », explique-t-il. « Les paysans et les éleveurs ne reçoivent que peu d’aides et sont négligés par l’État, ce qui fait que les produits d’importation sont moins chers et font concurrence à la production locale ». La frontière iranienne, à 35 km, fournit une des autres activités économiques de la ville. À deux pas de la mairie, le thé au goût de cannelle qu’on sert dans les passages, sortes de marchés couverts, vient d’Iran. Les vitrines des échoppes sont remplies de boites de cigarettes, de tabac, de thé, de dattes et de bibelots ramenés en contrebande du pays voisin. Au lieu de payer les taxes, les passeurs versent des pots de vin aux soldats et aux autorités qui ferment les yeux sur ce commerce informel. Dans nombre de maisons kurdes, on est fier de ne boire que du « kaçak çay », du thé de contrebande, et ainsi de ne pas verser de taxes à l’État. Dans le passage désert, les vendeurs guettent les rares clients. Comme l’explique M. Ekelik, depuis le début de la pandémie, la frontière est fermée et il est difficile de faire venir des marchandises, sans compter que le virus n’incite pas les acheteurs à se déplacer. Cela contribue à augmenter le taux d’inactivité, dans une ville où il n’y a pas d’industries, et où l’État n’a guère contribué au développement. En pleine matinée d’un jour de semaine, les rues et salons de thé sont remplis d’hommes désœuvrés. La chaussée boueuse et pleine de nids de poules témoigne de la négligence des pouvoirs publics, tout comme la longue file d’attente devant la Poste où, en dépit de toutes les règles sanitaires en cette période de pandémie, s’entassent des dizaines de personnes entre des grilles de police. Les trois ou quatre fonctionnaires qui y travaillent ne sont pas à la hauteur des besoins locaux.
La situation est particulièrement difficile pour les femmes, affirme Mme Öztürk. Dans cette région rurale, beaucoup d’entre elles n’ont accès qu’à une éducation élémentaire et sont ensuite poussées à se cantonner aux tâches domestiques et à s’occuper des enfants, alors que les politiques étatiques incitent à la natalité avec des aides pour les familles nombreuses. Comme l’explique la co-présidente du HDP, cela constitue un frein à la connaissance de leurs droits, à leur émancipation et à leur participation à la vie politique. Jusqu’au sein même du parti, les femmes doivent se battre contre les mentalités patriarcales, renforcées par la répression subies par les femmes qui s’engagent ouvertement en politique. Les voir arrêtées, emmenées en garde à vue, renforce l’idée chez les hommes que ce n’est pas leur place. « Nous organisions des formations pour nos militants hommes sur ces questions, tous les 15 jours pendant 3 mois », explique Mme Turan, alors qu’un homme âgé toussote, semblant gêné. « Mais avec la pandémie, puis la répression, nous avons dû arrêter nos activités », reprend-elle. Même chose pour un projet de coopérative de femmes, fermée par l’État, ou pour le centre d’accueil pour les femmes victimes de violences dans une autre ville de la région.

Dans le local du HDP, la conversation tourne à présent autour de la fête du Newroz le 21 mars, le nouvel an kurde, symbole de renaissance – et de résistance. Sera-t-elle autorisée ou pas ? Pour le moment, les négociations qui tiennent du bras de fer sont en cours avec les autorités. Accepter la tenue de l’événement serait une petite victoire pour le HDP, refuser le risque de voir des émeutes éclater… Sur le grand bureau du local de direction, des cartes postales colorées ont été imprimées pour être envoyées à des détenu.es en signe de soutien, alors qu’une grève de la faim est en cours depuis plusieurs dizaines de jours. Parmi les quelques personnes assises sur les fauteuils autour de la pièce, tou.tes ont connu la prison. Un homme d’une quarantaine d’années, bottes de chantiers aux pieds et vêtements de travailleur, bonnet vissé sur la tête, est sorti récemment d’une incarcération de 3 mois. S’indignant du silence de l’Europe face aux violations des droits humains commises par la Turquie sur les Kurdes, il tient à raconter les tortures qu’il a subies ou dont il a été témoin. Tabassages, écouteurs mis de force sur les oreilles et diffusant à plein volumes des chants fascistes et racistes… Cellules surchargées où les détenus s’entassent les uns sur les autres, et où les gardes laissent volontairement des malades atteints du covid… Refus de soins pour les malades, ou tortures encore à l’hôpital, avec des opérations dentaires sans anesthésie, et des « erreurs » comme quand parfois le dentiste arrache la mauvaise dent… Alimentation infecte qui donne des maux d’estomac… Comme témoigne un autre homme, une fois placé sur la liste des militant.es politiques, un simple contrôle sur la route à un des nombreux checkpoints autour de la ville, un appel du commissariat, ou encore la participation à une activité politique suffisent pour être placé en garde à vue et emprisonné de nombreux jours sans jugement. Les bergers dans les montagnes sont particulièrement visés, accusés d’aider le PKK quand ils se regardent dans les pâturages avec leurs troupeaux. À chaque nouvelle arrestation, les militant.es se voient proposer la tranquillité, voire même des aides, à condition qu’ils arrêtent leurs activités politiques. Pour l’État, la région du Serhat, foyer historique de résistance contre l’État, lieu d’une des plus importantes révoltes kurdes qui fondera l’éphémère république kurde de l’Ararat en 1927 avant d’être écrasée en 1930, doit être matée à tout prix. Mais pour les militant.es kurdes comme Mme Öztürk, ou M. Ekelik, « berxwedan jiyan e » (la résistance, c’est la vie).
Par Zozan Laylek