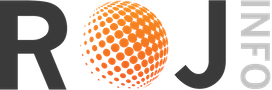Les politiques répressives mises en œuvre par l’État turc ont fait de Van, une des plus grandes villes du Nord-Kurdistan, une zone où l’interdit règne en maître.
L’état d’urgence mis en œuvre par le gouvernement turc au lendemain du putsch avorté de juillet 2016 n’a, de fait, jamais été levé à Van, faisant de la deuxième plus grande ville du Nord-Kurdistan, après Diyarbakir, une zone de non-droit absolu. Nous publions ici la traduction d’une chronique publiée par Firat News, dans laquelle, l’auteur, Mîna Roj, décrit une ville où la vie culturelle, économique et sociale est étouffée par les interdits.
Dès que j’entre dans la métropole kurde de Wan (Van), les canons à eau, les véhicules blindés, les barrières de chars, les murs et les postes de contrôle massivement fortifiés, ainsi que les forces spéciales lourdement armées à chaque coin de rue, me rappellent que l’état d’urgence est en place ici sans interruption depuis cinq ans. Personne ne peut se déplacer à Wan sans être contrôlé plusieurs fois.
La province kurde de Wan, au nord, est limitrophe de la frontière turco-iranienne avec le Kurdistan oriental, à l’est. Cependant, les postes-frontières, l’une des plus importantes sources de revenus pour cette région appauvrie, sont fermés depuis le déclenchement de la pandémie de Corona. Alors que toutes les frontières sont ouvertes en Turquie, le point de passage de Kapıköy vers le Kurdistan oriental est fermé à long terme. La Chambre de commerce et d’industrie de Van et d’autres organisations de la société civile, ainsi que des partis politiques, ont protesté, à de nombreuses reprises, contre cette situation. Le gouvernement les a qualifiés de « terroristes ». Le député de l’AKP [Parti de la Justice et du développement, au pouvoir en Turquie, ndlr] Irfan Kartal a déclaré qu’une éventuelle ouverture du poste-frontière de Kapıköy serait une « catastrophe ».
Parler en kurde, c’est faire de la politique
Je marche dans les rues les plus fréquentées de la ville et, à travers le flot de personnes, dans les rues secondaires, vers la mosquée Hasrettin Omar. Tous ceux qui connaissent cet endroit savent qu’il y a des commerces partout. Il y a la rue des marchands de tabac, des marchands de fromage et des tailleurs. L’état d’urgence permanent se reflète dans les conversations des gens, dans leur vie. Avec la répression sur la ville, les gens ont cessé de parler. C’est du moins ce que je constate. Maintenant, si nous ajoutons l’extrême pauvreté de la population, nous pouvons comprendre à quel point la situation est dramatique.
Les étals sont pleins à craquer, mais personne n’achète rien. Je parcours tout le marché. Je vais de magasin en magasin et je parle aux propriétaires. Je leur souhaite, en kurde, bon courage dans leur travail, mais ils ne répondent généralement pas en kurde. Un employé d’une boulangerie me dit : « Ma sœur, ne fais pas de politique ici ». Parler le kurde est bien sûr quelque chose de politique, mais je suis profondément frappée par la réaction de ce boulanger qui essaye simplement de gagner sa vie.
« Cet État veut nous affamer »
Faruk B., 60 ans, vend des outils, des piles, des chargeurs et des stylos à plume sur son stand. « Notre pays est pauvre », dit-il. Lorsque je lui demande à quel point il est affecté par la fermeture du poste-frontière, il répond à mes questions en regardant les gens qui vont et viennent : « Ils parlent de raisons de sécurité. Ceux qui meurent aux frontières sont aussi des gens du peuple. Les Kolbars risquent leur vie pour gagner trois sous. Cet État essaie délibérément de nous affamer. Edirne, bien sûr, n’est pas affectée par le virus. Que puis-je dire de plus ? »
« La pauvreté est aussi une forme de violence »
Que peut-il dire de plus ? Et un jeune homme dans le magasin d’à côté avertit : « C’est facile de parler, mais ensuite on s’inquiète. N’écrivez pas mon nom, ne me prenez pas en photo. Mon frère est en prison depuis sept ans. Je ne veux pas y aller aussi. Je viens ici tous les matins et j’ouvre mon étal. Mon revenu quotidien se situe entre 70 et 100 TL (entre huit et onze euros). Je m’occupe seul d’une grande famille. Je n’arrive pas à joindre les deux bouts. La pandémie est une excuse. Ils veulent que les gens restent pauvres ici. La pauvreté est aussi une forme de violence. Regardez dans ces rues, des dizaines de milliers de jeunes qui vont et viennent. Ils n’ont pas de travail. »
Ciwan Haco [célèbre chanteur kurde, ndlr] chante dans un haut-parleur. Je voudrais m’arrêter un instant et filmer. Mais dès que je m’arrête, le marchand de CD éteint la musique. Quand je m’éloigne, il remet la musique en marche. Son comportement est logique : il a peur qu’on ne porte plainte contre lui et que son magasin soit fermé.
« Nous sommes affamés et nous avons peur »
Il en va de même pour le marché du tabac. On y vend surtout du tabac de Semsûr (Adiyaman). Bien que Bedlîs (Bitlis) soit tout près, dit A.Y., le tabac qui vient de là-bas est trop cher, les gens n’ont pas assez d’argent pour l’acheter. « Cette ville avait une âme, soupire le vendeur de tabac. Maintenant, c’est un endroit sans âme. Je suis diplômé de l’université. Je suis né, j’ai grandi et j’ai étudié dans cette ville. Je ne peux même pas travailler au salaire minimum. Maintenant, je vends du tabac. Mais il n’y a personne pour l’acheter. Avant, on se plaignait du flot de touristes iraniens. Maintenant, nous avons besoin d’eux. Tant que le poste-frontière est fermé, il n’y a pas de commerce. Un Iranien peut prendre l’avion jusqu’à Istanbul et revenir à Wan, mais il ne peut pas faire quelques heures de route pour venir à Wan par la frontière. Le virus est un prétexte absurde. Ils parlent de raisons de sécurité plus que de toute autre chose. Erdoğan devrait dire où se situe ce problème de sécurité. La pandémie existe depuis un an, mais l’état d’urgence est en vigueur ici depuis cinq ans. Demain, ils donneront une autre raison. Ils veulent que nous mourions de faim, que nous vivions dans la peur, sans identité. Ils ont réussi au moins en partie, nous sommes affamés et nous avons peur. »
« Nous attendons l’ouverture du poste-frontière »
Même son de cloche dans la rue où sont vendus les produits textiles traditionnels kurdes. Il n’y a pas de mariage, donc personne pour commander robes. De nombreux clients de ces magasins venaient d’Iran. « Si nous vendions une robe par semaine, dit le commerçant Sabri K, nous pourrions gagner de quoi vivre un mois. Les femmes achètent parfois des tissus pour coudre des jupes, mais ce sont des tissus à bas prix, environ 30 à 50 TL. Cet argent ne nous sauve pas. Nous attendons l’ouverture du poste-frontière. Peut-être qu’alors les choses iront mieux. »
« L’AKP veut maintenir un état d’urgence de facto au Kurdistan »
Je demande au député du HDP (Parti démocratique des Peuple) Murat Sarısaç de me faire part de ses observations. « L’AKP, dit-il, veut maintenir un état d’exception de facto au Kurdistan. Le peuple n’est pas seulement privé de ses droits politiques, mais aussi de ses droits économiques. D’un côté, la ville se voit imposer un administrateur d’État [agent désigné par le gouvernement en lieu et place des co-maires HDP destitués, ndlr], et de l’autre, les habitants de Wan ne sont pas autorisés à profiter des 395 kilomètres de frontière avec l’Iran. On ne parle de Wan que lorsque des gens meurent à la frontière. Toutes les décisions à Wan sont prises par un gouverneur assisté de quelques bureaucrates. »