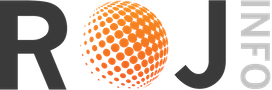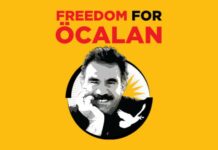Trente-sept ans après le génocide d’Anfal perpétré par le régime baassiste de Saddam Hussein, les familles des victimes continuent d’attendre que justice leur soit rendue.
À l’occasion de cette date commémorative, les organisations travaillant sur les génocides ont tenu une conférence de presse au siège du Parti communiste du Kurdistan à Souleymaniye.
Dans sa déclaration, Bextiyar Mustafa a rappelé que jusqu’à 182 000 Kurdes, ainsi que des membres des minorités assyro-chaldéennes, ont été massacrés entre 1986 et 1989, dans le cadre d’une campagne systématique de nettoyage ethnique baptisée « Anfal » – un terme tiré du Coran signifiant « butin de guerre ».
« Un crime contre l’humanité a été commis. Malgré la reconnaissance officielle du génocide par le tribunal suprême en 2007, aucun des responsables identifiés n’a été jugé ni extradé via Interpol », a dénoncé Mustafa.
Des revendications restées lettres mortes
Les organisations ont formulé une série de revendications, restées sans réponse depuis des années :
-
L’extradition, via Interpol, des responsables du génocide visés par des mandats d’arrêt émis le 20 mai 2007 ;
-
L’exhumation des fosses communes et l’identification des victimes par des tests ADN ;
-
Des excuses officielles du gouvernement irakien aux victimes du génocide ;
-
L’indemnisation complète des rescapés, anciens prisonniers politiques et victimes d’armes chimiques ;
-
La transformation de la base militaire de Topzawa en musée de la mémoire ;
-
L’ouverture d’une enquête sur la destruction de la base de Dubiz.
« Malgré nos multiples appels, aucune action concrète n’a été entreprise. Le silence persiste », a déploré Mustafa.
Une campagne d’extermination planifiée
L’opération Anfal, dirigée par Ali Hassan al-Majid, surnommé « Ali le Chimique », visait à éradiquer toute présence kurde dans le nord de l’Irak. Organisée en huit phases, elle a culminé en 1988 avec des vagues d’attaques, de déportations, de destructions massives de villages et le tristement célèbre bombardement chimique de Halabja le 16 mars 1988.
Outre les morts, la campagne a entraîné la destruction de plus de 4 000 villages, 1 800 écoles, 300 hôpitaux, 3 000 mosquées et 27 églises. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées, internées dans des camps, privées de nourriture et de soins.
En 2006, le Tribunal pénal spécial irakien a reconnu les crimes du régime baassiste comme un génocide. En 2007, plusieurs anciens hauts responsables, dont Ali Hassan al-Majid, ont été condamnés pour crimes contre l’humanité.
Mémoire et devoir de justice
Depuis 2004, le 14 avril est dédié à la mémoire des victimes d’Anfal au Kurdistan. Si le génocide est reconnu, la justice reste incomplète. Les familles des disparus attendent toujours vérité, reconnaissance et réparation.