Sur est le centre historique de Diyarbakir, en kurde Amed, ville du sud-est de la Turquie, sorte de capitale informelle du Kurdistan turc. Elle compte un peu plus d’un million d’habitants et se développe de façon singulière, ne s’étendant pas en cercle, mais intégralement vers l’Ouest, à l’horizontale. La ville originaire, Sur, était un centre urbain il y a déjà 3000 ans et surgit sur les rives du Tigre, où se trouvent les terres plus fertiles. Diyarbakir s’est par la suite développée du côté opposé, vers l’occident, ce qui explique pourquoi Sur, tout en étant le quartier historique de la ville, n’en soit pas le centre mais plutôt une extrémité isolée. Les imposantes murailles d’origine romaine qui l’entourent contribuent à le séparer du reste du tissu urbain.
Sur est un quartier populaire très vaste, un magnifique labyrinthe de maisons, mosquées, monuments, cafés, marchés. C’est l’un de ces lieux qui possèdent cette étrange propriété de faire découvrir à l’observateur de nouvelles choses à chaque visite.
Déjà avant le conflit de 2015-16, Sur était dans le collimateur des spéculateurs. Un centre historique magnifique, à côté de deux merveilles architecturales – la forteresse de l’Ic Kale avec son parc et les murailles – et dans une grande ville, en fin de comptes facilement accessible : un beau prospectus. Problème : ceux qui habitent cet espace si prometteur sont des Kurdes en majorité pauvres. L’Etat leur est hostile par définition – sentiment qu’ils partagent de leur côté.
La guerre invisible
Je n’ai aucune prétention de m’afficher parmi les experts de la question kurde. Ce fait ne m’empêche pas de constater que chaque personne que j’ai rencontrée a un parent, un fils, une amie, un amant qui a été tué, emprisonné ou torturé – sinon l’interlocuteur lui-même. Un activiste de l’HDP (le Parti démocratique des peuples, pro-kurde) se souvient du soir où les soldats turcs ont tué son voisin à bout portant sous ses yeux. Une amie ingénieure raconte le jour où, encore enfant, les forces spéciales turques ont attrapé son frère ainé par les jambes pour le suspendre par le balcon. Ils cherchaient son oncle, combattant au sein du PKK. Une fille a été emprisonnée à la fin du lycée : elle portait une pancarte à une manif sur laquelle était écrit : “vive le confédéralisme démocratique.” Une autre a dû quitter la ville où elle travaillait, cette dernière ayant été rasée au sol après les combats de 2015.
De l’automne 2015 au printemps 2016, à Sur il y a eu la guerre, comme dans d’autres villes du Kurdistan turc. Pourtant, si un touriste se trouvait à se promener à Sur aujourd’hui, il pourrait très difficilement repérer les traces de la guerre qui a frappé le quartier. Ce serait même impossible, car le quartier n’existe plus : les premiers districts à avoir été démolis sont ceux où l’on a combattu.
Sauf pour de grosses écritures à la bombe rouge, PKK, YPG, Biji Apo (vive Apo, soit Ocalan), effacées avec de grands traits et substituées par des croissants noirs, il ne reste plus grand-chose pour raconter l’histoire d’un des plus graves épisodes militaires dans l’histoire récente de ces terres. Un siège en bonne et due forme d’une population civile durant plusieurs mois, mené par l’armée d’un état sur son propre sol et contre ses propres citoyens.
Plus de 2000 personnes dans toute la région, dont 300 civils, ont perdu la vie au cours des combats. De tout cela il ne reste aucune trace – et c’était il y a peine deux ans.
Dans des villes telles que Sarajevo ou Beyrouth, il est facile de tomber sur les traces de rafales de mitraillette et sur les trous d’obus ; à Sarajevo, l’Holiday Inn est pratiquement un monument de la guerre, tout comme le cinéma détruit de Beyrouth : vestiges de guerres terminées il y a 25 ans. A Diyarbakir, en l’espace d’un millier de jours, tout a été effacé.
A la fin de l’été 2015, l’interruption des pourparlers entre le PKK et le gouvernement, la guerre en Syrie, les attentats (dont un en juin, à un rassemblement de l’HDP à Diyarbakir, avait causé la mort de 5 personnes), avaient exacerbé un climat déjà explosif.
En automne, c’est la région entière du Bakûr qui s’enflamme. Les révoltes ne sont plus des journées d’affrontements avec la police ou des combats sur la crête des montagnes, mais de véritables insurrections urbaines. Cizre, Diyarbakir, et les autres centres urbains kurdes deviennent le théâtre de barricades, de prises de pouvoir et enfin de déclarations d’autonomie. En première ligne sont les jeunes du Ydg-H : un mouvement politique de jeunes armés proche du PKK, d’origine étudiante.
La réaction de l’état turc, qui avait botté en touche en premier recours, se caractérise pour une violence inouïe qui, à Diyarbakir, devient finalement guerre ouverte et siège par la suite. Le mot-clé ici est “couvre-feu.” Le premier est imposé aux habitants de Sur en septembre. En décembre, celui-ci devient permanent. Face aux armes légères des militants, arrivent dans la ville les tanks, les mortiers, les forces spéciales.
Alors que la bataille fait rage, que les snipers tirent et que les tanks détruisent les maisons, le 1er février 2016, le premier ministre turc Ahmet Davutoğlu déclare à l’agence de presse de l’état que Sur allait être restaurée “de façon si belle” qu’elle allait devenir “une attraction touristique.” L’idee, c’était de faire “exactement comme à Tolède,” la ville espagnole détruite pendant la guerre civile. Le tout, en respectant “le tissu architectural” et culturel du quartier.
Le plan du quartier est formé d’une constellation irrationnelle de ruelles, souvent si étroites qu’il est impossible de voir le ciel autour (fort heureusement car en été il fait régulièrement plus de 40 degrés). Il y habitaient presque cent mille personnes, réparties sur 15 districts jusqu’à il y a deux ans et demi. Aujourd’hui il n’en restent que huit. Les autres ont été démolis, rasés au sol à partir de 2016 par l’armée turque.
***
Fatma Ates a mon âge, 28 ans. Elle a les yeux marrons, et elle est fine comme la soie, à peine une couche de chair sur ses os. Elle n’a rien du physique de sa mère, à en juger par les photos éparpillées dans la maison, dont elle partage pourtant le prénom : elle aussi s’appelait Fatma. Elle s’assoit, offre du thé et raconte son histoire. Sa voix est monotone, inexpressive.
Nous avions décidé de rester dans le quartier, malgré la bataille. Je n’ai jamais regretté cette décision. C’était notre choix, personne ne nous a contraint à rester, ni à partir. Ma mère était très connue dans le quartier, les combattants l’appelaient anne (mère). Elle cuisinait pour eux, les soutenait. Elle était une figure de référence… J’ai grandi à Sur, mais je suis née dans un village nommé Seyrantepe, à environ 150 km de Diyarbakir. C’est l’un de ces villages détruits par l’armée turque dans les années 90. Après que l’armée avait détruit leur maison, mes parents – comme des dizaines de milliers d’autres – se sont installés à Sur. Ma mère répétait toujours : j’ai laissé ma maison une fois, je ne le ferai plus jamais. Elle ne voulait pas partir, par peur que la maison ne soit détruite, elle ne voulait pas partir pendant que les jeunes combattaient. Mais en février notre maison n’était déjà plus là. Elle avait été détruite par un tank… regarde, je te montre une vidéo. Je l’ai trouvée hier sur les réseaux sociaux.
La vidéo qu’elle me montre est signée par l’une de plus importantes agences journalistiques turques. Sur l’écran du smartphone s’ouvre une scène inquiétante : une série de blindés type Cobra sont garés au milieu d’une zone de bâtisses presque entièrement détruites. C’est Sur, le 21 Février 2016, district de Hasirli, aujourd’hui rasé au sol. Le cadre de l’image tourne vers la droite, jusqu’à inclure trois soldats qui, très agités, surveillent un groupe de civils en train de s’approcher. Tout autour, des édifices détruits. Lumière froide hivernale.
“Là c’est moi, ma soeur et mon père,” dit Fatma. Chacun d’entre eux tient par un bout un tapis, aidés par deux autres hommes. Le tapis parait très lourd, on les voit avancer courbés sous son poids. Les soldats hurlent. Fatma reprend son récit.
Dans le tapis il y avait ma mère. Nous étions dans la maison, pas la nôtre, qui avait été détruite comme je t’ai dit, on s’était déplacé dans une autre avec d’autres familles de déplacés. Il devait être midi quand l’armée a commencé à frapper avec les mortiers. Un obus est tombé très proche de nous, les éclats ont touché ma mère entre l’épaule droite et le dos et à la jambe droite. Elle était gravement blessée, mais consciente. On a appelé les secours, cependant le couvre feu et le siège ont empêché l’arrivée de l’ambulance, qui n’est venue que quatre ou cinq heures plus tard. Puis on a pris une banderole blanche, le tapis et ma mère et on est allé vers la police.
Regarde, tu vois ? Les soldats prennent le tapis, le mettent dans l’ambulance. Nous, ce sont les policiers qui nous ont pris et qui nous ont arrêtés. A cet moment-là, ma mère était toujours vivante, elle parlait. Ce n’est que pendant que l’on était en détention que l’on a su qu’elle était morte. Nous n’avons jamais su, en revanche, si elle a été soignée ou pas. La police la recherchait, et quand je suis passée devant le juge d’instruction, ce dernier m’a dit que j’allais payer pour les fautes de ma mère.
A ce moment-là, une amie qui m’accompagne en tant que traductrice éclate en sanglots. Moi et le photographe restons en silence. La traductrice embrasse Fatma pour la consoler, elle me tourne le dos. Fatma me regarde : elle est très mal à l’aise, évidemment embarrassée.
Pendant les deux heures et plus d’interview, Fatma ne montre aucun signe d’émotion, c’est peut-être pour cela qu’elle est gênée. Elle raconte son histoire comme s’il s’agissait d’une recette de cuisine. C’est peut-être cette froideur qui fait peur à l’état turc, qui a motivé le gouvernement à raser au sol Sur et à en finir avec ce quartier une fois pour toutes. Passé le moment d’émotion, Fatma termine son histoire.
J’ai fait un an et demi de prison avec mon père. Je dois pointer en caserne tous les jours. Ma soeur, qui avait 23 ans à l’époque, est toujours en prison. Tout cela seulement parce que nous avions choisi de ne pas quitter notre maison et que, par conséquent, nous devions forcément être des terroristes.
On m’a cassé un bras. Au tribunal. Pendant l’une des audiences, une vingtaine de militaires se sont jetés sur moi. L’avocat a protesté, mais le juge a rétorqué que de toute façon, les caméras de surveillance étaient éteintes.
Ainsi, quand lors d’un interrogatoire un policier m’a demandé si le fait qu’autant d’agents de police soient morts pendant le siège de Sur me posait problème, j’ai répondu que non, ça ne me posait aucun problème.
***
Impossible de repérer cet endroit, si personne ne t’indique le chemin. Il faut pénétrer dans ce labyrinthe qu’est Sur, et se perdre par la suite. Une marche et un panneau signalent l’entrée du hammam. Qui n’est plus un hammam depuis des décennies, peut-être des siècles, selon l’homme qui accueille les (très peu nombreux) clients derrière le zinc improvisé.
Au milieu d’une grande salle où il fait frais il y a une dizaine de tables, on apporte le café et je parle avec Idriss, le chanteur. “Je suis devenu chanteur en écoutant Şivan Perwer. Il était un héros pour nous, il avait le courage de chanter en kurde à une période où il suffisait d’un mot pour te faire pourrir en prison.”
A chaque fois que j’ai rencontré Idriss, sa veste était sans un pli, la chemise parfaite, chaque geste mesuré, étudié.
Sa maison, dit-il, a “au moins cinq-cent ans.” C’était une propriété arménienne. Qui sait, peut-être que Idriss a du sang arménien dans les veines, comme beaucoup d’autres habitants de la zone. A Sur ont vécu Romains, Assyriens, Arméniens, Juifs, Turcs et bien d’autres, parfois ensemble parfois non. Sa maison n’est plus à lui : elle a été réquisitionnée par l’état juste après la fin des combats. “Quand je chantais en kurde les chansons de Perwer, dans les années 80, parfois les gens partaient en courant. A cette époque on pouvait finir en prison pour un vinile. On m’a arrêté des dizaines de fois, et à chaque fois dans la cellule je chantais, en kurde.” Aujourd’hui Idriss ne chante plus, mais il s’interesse toujours à la chanson populaire, à la langue kurde. “Aujourd’hui ce qui marche est plutôt la chanson politique, ou la pop. Je ne suis plus intéressant.”
***
Même si la plupart des traces de la guerre ont disparu, mais certaines sont dures à supprimer. Face à la mosquée du Sheikh Mokhtar, il y a un minaret bien étrange. Une tour en roche blanche et noire, qui date de 900 ap. J.-C. selon les guides touristiques. Elle est posée sur quatre piliers, qui symbolisent les quatre écoles théosophiques de l’Islam sunnite. La surface des colonnes du minaret est marquée par des impacts de balles. Dans ce même endroit, des pistolets ont tué Tahir Elçi le 28 novembre 2015.
Tahir Elçi était avocat et président de l’association des avocats de Sur, une figure de référence en Europe et à Diyarbakir pour tout ce qui regardait la défense des droits de l’homme et du patrimoine culturel de Sur. Vers la fin de novembre, la guerre était déjà bien avancée, quoique de façon intermittente. Les couvre-feux imposés par le gouverneur étaient à cette époque encore limités dans le temps. Des représentants des syndicats et de la société civile avaient appelé à un sit-in pour que l’on arrête les opérations militaires et la destruction de la ville. Quelques centaines de personnes s’étaient retrouvées face à la mosquée, à l’ombre du minaret. C’était un moment de calme relatif. Tahir Elçi était en train de parler, quand des hommes – dont on n’a jamais découvert l’identité – lui ont tiré dessous. Il est mort sur le coup, un projectile dans le crâne.
Dans le bureau du Me Ahmet Özmen, 39 ans, il y a une espèce de vitrine qui contient une chemise Tommy Hilfiger, taille L à rayures blanches et rouges, New York fit. A ses côtés est posée une ceinture en cuir noir et, au dessus, une photographie : Tahir Elçi, endossant cette même chemise.
“La famille nous l’a donnée,” explique Me Özmen. Après la mort de Elçi, il a été nommé président de l’association des avocats de Sur. N’a-t-il pas peur ? Après tout, son prédécesseur a été tué par balles. “Je reçois chaque jour des menaces – dit-il en haussant les épaules – mais quelqu’un doit bien faire ce travail.” Il allume la télé sur la rediffusion de Brésil-Belgique, et raconte : après la démolition de 2016, le gouvernement a réquisitionné 82% des bâtiments de Sur. “Ils ont fait estimer la valeur des bâtiments, et les ont expropriés par la suite.” Sans fournir aucune justification. Il suffit de payer les autorités, et n’importe quel occupant de n’importe quelle maison est forcé a quitter les lieux, sans appel.
***
En haut des anciennes murailles de Sur, bâties par les Romains autour du IV siècle av. J.-C., le panorama est déprimant. Une vaste plaine en friche s’étend là où jadis était la moitié de Sur. Maintenant c’est de la terre sauvage, habitée par les mauvaises herbes. Il y a une route toute neuve, qui semble partir du néant et vise vers les murailles, s’entortille dans un rond point désert et retourne par là d’où elle est venue.
Des ouvriers dirigent une coulée de beton dans des fondations. Ici et là, quelques bâtiments nouveaux, vides. La police patrouille la zone, l’entrée est interdite, et le tout entouré par une très longue cloison de chantier. La barrière coupe le quartier à moitié, d’un côté les maisons encore existantes et ce qui reste d’une ancienne ville, de l’autre rien. Cette espèce de mur se déroule le long de plusieurs kilomètres. Le photographe commente : “ça ressemble au mur entre le Mexique et les Etats-Unis.”
Parfois le mur doit céder le pas a des bâtiments qui, pour leur malheur, se trouvent sur son parcours. Alors la frontière se transforme, devient un mur en pierre, ou une barriere en fer mobile, où il est écrit à grandes lettres bleues : POLIS. Il suffit de pousser l’une de ces barrières pour acceder à la zone interdite. Puis de se faufiler à droite, ne se souciant pas trop des aboiements d’un chien, et après une centaine de mètres on se retrouve dans la maison de Emrullah, qui aime se faire appeler Kevin, mais que tout le monde appelle Emre.
Emre était dans l’armée américaine. Il a servi en Irak, en tant qu’interprète dans les zones kurdes. Près de Mosul, en 2007, il a été blessé par une mine. L’épisode lui a valu une longue cicatrice sur la jambe. Depuis, il vivait à San Diego et s’était décidé à rentrer à Diyarbakir à l’été 2015, pour rénover la vieille maison de famille à Sur. Quelques mois après, la guerre éclatait, et adieu les travaux, les plâtres, les meubles.
La maison est magnifique, ou bien elle le serait. C’est le prototype de l’ancienne maison de Sur : une cour centrale à l’ombre d’un grand arbre, avec des pièces tout autour. Dans celle qui fait l’un des angles de la maison, et dont les fenêtres donnent sur l’esplanade en friche, ils restent des traces du conflit. Le sofa délabré posé au centre est troué par les brulures des cigarettes. Autour, des dizaines de douilles de fusil. L’orientation des fenêtres et les pierres épaisses du mur font de cette pièce une position de tir excellente, exploitée selon Emre par les forces spéciales turques lors du siège de Sur. Emre est plutôt riche, il ne représente en rien l’habitant typique de Sur. Il affirme que sa famille a des connexions importantes avec le pouvoir régional, il dit connaître tel parlementaire, le cousin d’un tel, et ainsi de suite. Pourtant, cela ne semble influencer en aucune mesure sur le processus d’expropriation collective qui est en marche à Sur : tout comme ses voisins pauvres, Emre a dû quitter la maison, ne sachant pas s’il pourrait remettre un jour la main dessus.
***
Les grands projets de construction menés sous le gouvernement de Erdogan à Istanbul ont modifié la carte de la capitale. Certains quartiers ont de fortes identités religieuses, politiques et socioéconomiques ; la destruction ou restructuration de quartiers entiers s’est souvent soldée par l’expulsion des habitants d’origine, substitués par d’autres plus favorables au gouvernement.
“Gentrification” est un terme aujourd’hui galvaudé. A Diyarbakir, cependant, il prend tout son sens : il ne désigne plus un simple phénomène social lié au marché de l’immobilier, mais la façon concrète dont le capital transforme politiquement les villes et les espaces où les gens vivent. L’alliance entre les constructeurs et l’état a fait en sorte qu’un grand projet de “re-qualification”, qui avait été rejeté plusieurs fois et contre lequel on enregistrait une forte opposition, soit approuvé et entamé sans aucune contestation. Le passage clé a été la guerre : une gentrification à coups de tanks et de mortiers.
Il serait excessif de dire que la guerre a été motivée par des projets immobiliers. La réponse de l’état, si destructive et violente, est certainement due à de multiples facteurs, parmi lesquels les élections et la rupture des négociations de paix avec le PKK. Cela n’empêche que la gentrification et les opérations militaires coïncident d’une façon tout à fait particulière.
***
Les ruelles du district de Ali Pasha, aux abords de Sur, finissent sur une sorte de place. Au fond, après la route en terre battue, il y a cette barrière de chantier dont on a déjà parlé ; et tout de suite avant celle-ci, il y la tente de Mehmet Ali, 60 ans et sa famille nombreuse.
Il a planté ses piquets entre la cloison et un pylône électrique, auquel il s’est attaché abusivement. Il est assis face à la tente, il lui manque presque toutes les dents, il a d’ énormes mains et des cheveux noirs clairsemés. Sa femme est assise à ses côtés, sa main posée sur une petite table où sont exposées des babioles variées. “Après la fin de la guerre ma maison était toujours sur pieds. Elle était juste ici, là où j’ai planté la tente – raconte-t-il – On nous a notifié la réquisition une première fois, et j’ai dit que je n’allais pas bouger. C’est notre maison.”
La famille de Mehmet compte plus d’une douzaine de personnes entre grand-mères, fils et neveux. La maison était récente, des années 90, sans grand intérêt du point de vue architectural : bonne pour la démolition, selon les autorités. “Puis ils sont venus une deuxième fois, et on a encore dit non. La fois d’après ils sont arrivés avec la police”, et ça a viré à la bagarre.
Le fils de Mehmet, grand et gros, retournera bientôt en prison (des petites histoires de drogue, dit-il). Entre-temps, il profite de ses journées de liberté entre le procès et la sentence en passant son temps avec sa fille, devant la tente du père. Il s’est fait des cicatrices sur les bras et sur le reste du corps avec des lames de rasoir. “Quand la police est arrivée, nous nous sommes battus, bien évidemment. J’ai jeté des pierres du toit. Puis je suis descendu dans la rue et je me suis battu avec douze d’entre eux.” Heureusement pour lui, les habitants ont réussi à le faire s’échapper par une ruelle, avant que ce ne soit trop tard.
Mehmet en somme vit dans la rue, avertissement tangible aux autres habitants de ce qui pourrait leur arriver d’un jour à l’autre. Il y a en effet une certaine solidarité : une femme laisse un sac de courses et dit : “vous me rendez orgueilleuse.”
A côté de la tente, sur un mur, Mehmet accumule les ruines du quartier et les restes des démolitions : des morceaux d’architraves et des murs anciens que l’on peut acheter pour quelques pièces. Ce sont des enfants qui lui ramènent ces matériaux depuis le fleuve, où les bulldozers ont déchargé une bonne partie des décombres de la guerre. Parfois, raconte-t-on, les enfants retrouvent des morceaux de corps humains. Mehmet se réjouit de cette sorte de résistance passive, campé comme il l’est sur les ruines de sa propre maison, qui ne lui appartiennent même plus. Pour lui, tout est très clair : c’est l’âme elle-même du quartier qui fait obstacle aux projets des urbanistes, éminemment politiques, voués à normaliser un quartier hostile au pouvoir de l’Etat.
***
Il est surprenant de constater comment le sujet de la transformation urbaine a servi à légitimer les opérations de guerre. Dans un discours qui associe le nettoyage ethnique et le nettoyage architectural, les notions de régénération urbaine et de lutte contre le terrorisme se font échos.
C’est un refrain qui a l’avantage de la ductilité. Si le quartier est rebelle, c’est qu’il est habité par des “terroristes”. Donc il est dégradé. Ca marche également à l’envers : si des “terroristes” ont décidé de s’implanter dans le quartier, soutenus par un bon nombre d’habitants, c’est à cause du fait que le quartier est dégradé. Dans les deux cas, il faut le réhabiliter.
Il ne faut pas non plus se préoccuper de l’ampleur des dégâts : l’espace ainsi libéré rendra possible une grande opération de reconstruction – d’ailleurs, ce sont justement les combattants et ceux qui les soutiennent qui s’opposent à ce processus de civilisation.
Ces alibis ont permis au gouvernement d’avancer avec ses projets, précédemment bloqués par les oppositions politiques et sociales. En ce sens, six mois de guerre font des merveilles. D’ailleurs, quand les journaux télévisés turcs racontent des opérations contre le PKK en Turquie ou en Irak, ils ne mentionnent pas de morts, mais seulement des terroristes neutralisés. Pareillement, à Diyarbakir il n’y a pas de démolitions, mais des rénovations.
***
La dernière histoire que je souhaite raconter est celle d’un fantôme. Le spectre d’une combattante que tous affirment connaitre dans les rues de Sur. Les cireurs de chaussures installés devant la mosquée garantissent l’avoir vue plusieurs fois ; un vendeur ambulant assure lui avoir parlé ; un père de famille jure connaitre un de ses cousins.
Tous l’appellent Rosa (selon un membre du HDP, c’est un nom de bataille très prisé par les guerrilleras, inspiré par Rosa Luxembourg). On dit qu’elle était une sniper très douée : ses exploits se racontent tels des sagas nordiques.
Il y en a qui disent qu’elle a tué à elle seule des dizaines de soldats. D’autres racontent cette fois où elle a tenu tête à un tank avec un fusil. On dit qu’elle a réussi à fuir le siège juste avant la fin, et qu’aujourd’hui elle combat avec les Ypg en Syrie.
Probablement, ce ne sont que des fantasmes, justement. Enfin, chaque village a le saint patron qu’il mérite, et Sur en a un tout à fait remarquable : une femme, tireuse d’élite, guerrillera.
Par Filippo Ortona
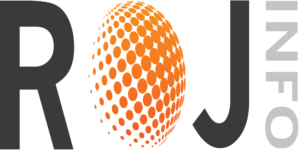
















Très belle article ! Merci pour ce travail !